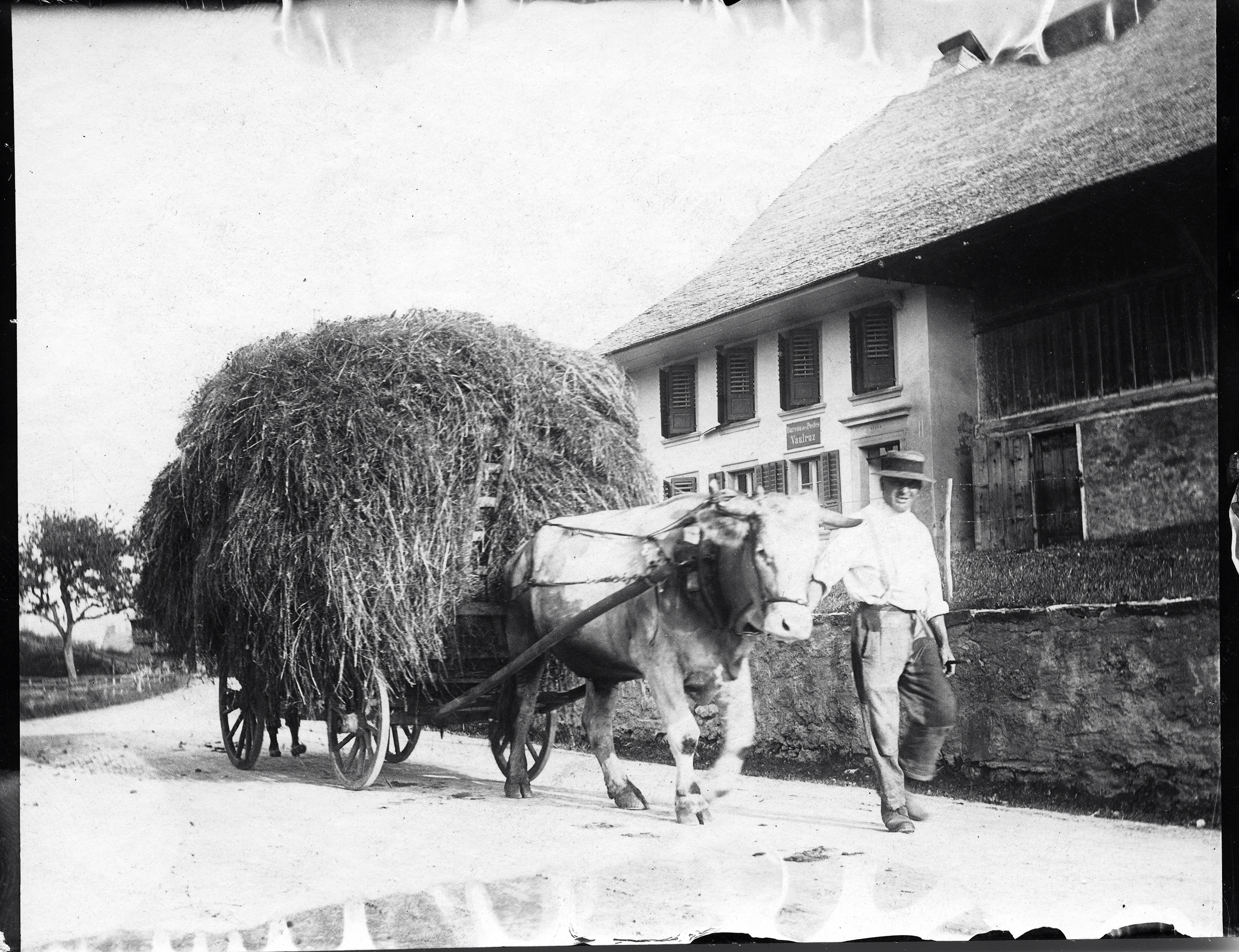Représenter la catastrophe: l’incendie, sujet photogénique?
Un incendie, dans l’objectif d’un photographe de presse, peut-il conjuguer à lui seul les conditions requises pour produire une image photogénique? Cette question a été examinée l’automne dernier dans le cadre d’un séminaire dispensé par le Prof. Claude Hauser à l’Université de Fribourg.
Une dizaine d’étudiants, dont je fais partie, ont eu l’occasion de se plonger au cœur des archives photographiques de La Liberté et ont chacun consacré un travail sur des sujets de l’actualité imagée du canton. Pas moins d’un millier d’images d’incendies sont conservées dans les archives du quotidien fribourgeois: des rues en feu, des logements privés, des forêts, de grandes usines et même de petites entreprises familiales. La question mérite d’être posée: pourquoi un tel intérêt photographique pour ce type d’évènements certes dramatiques, mais plutôt fréquents? Cette large couverture répond sans doute à la demande d’un lectorat attaché au patrimoine architectural du canton. Les Fribourgeois se souviennent des journées noircies par les cendres de l’Hôtel de Zähringen (1974) ou du Werkhof (1998). Au-delà de l’aspect identitaire, les images d’incendies troublent et séduisent l’œil curieux. Ces photographies spectaculaires font vivre à quiconque les observe un sentiment paradoxal, mélange de frayeur et de fascination. Mais cette esthétique du sublime suffit-elle pour qualifier ces images de «photogéniques»?
Quatre temps forts de l’incendie… tous photogéniques?
Souvent pris dans le feu de l’action, les photographes de presse ont d’ordinaire pour ambition première de délivrer des images informatives et non ce qu’on appelle communément de «belles photographies». Dans certains cas, l’incendie semble échapper à cet impératif documentaire et le reporter peut parfois aspirer à une certaine autonomie esthétique. Les images consultées dans les archives de La Liberté couvrent quatre moments clés du drame, avec des attraits variables. Si les flammes sont les actrices les plus fameuses de l’incendie, elles ne monopolisent pas forcément l’attention. Leur force d’attraction – vraisemblablement conjuguée à leur potentiel commercial – est fréquemment exploitée à la une, mais pas systématiquement dans le corps du journal. Les rédacteurs usent du pathos qui émane de ces clichés afin de captiver l’attention du lecteur. Bien que ces vues déclenchent la sidération du spectateur devant l’ampleur des dégâts, les photos que l’on rencontre le plus souvent dans le quotidien tendent davantage à la réinscription des faits tragiques dans une histoire. Le travail humain, en premier celui du pompier, est le point de départ des récits qui semblent faire fi de la qualité de ses illustrations. Dans les archives, rares sont les images de victimes ou de civils. Ces quelques portraits d’hommes et de femmes, indépendamment de leur qualité et de leur prétention esthétique, s’adressent néanmoins directement aux sentiments du lecteur et se soustraient ainsi à leur simple rôle informatif. Enfin, le spectacle des ruines conjugue à lui seul considérations informatives et esthétiques; les images des décombres traduisent tout autant la brutalité de l’incendie que la troublante beauté qui émane du chaos.
Dans le cadre de la presse quotidienne, l’incendie brouille les frontières entre photographie esthétique et informative. L’incendie n’est pas un sujet photogénique en soi, encore moins lorsqu’il est traité par un photographe de presse dont l’intérêt artistique est relégué au second plan. Photogéniques, ces images le deviennent surtout dans un second temps grâce aux projections personnelles des lecteurs et à la prouesse des photographes qui subliment la réalité pour produire des photographies mémorables.
Thelma Debons
Université de Fribourg